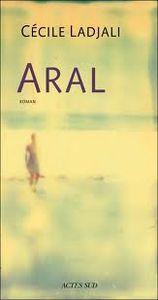La faille de Jorn Riel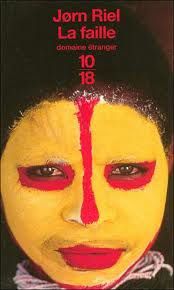
Après vous avoir présenté Le jour avant le lendemain de ce même auteur, roman qui reste ancré dans mon coeur comme LE roman-phare de ma vie de lectrice, voici un autre roman de Jorn Riel. J'ai lu beaucoup de ses racontars et romans, qu'il faudrait que je prenne le temps de vous parler un peu, mais La faille garde une place à part dans la bibliographie de l'explorateur-écrivain.
Le titre même du livre témoigne de son caractère extra-ordinaire : il préfigure une fêlure, un gouffre. Etymologiquement, la faille nous vient de l'ancien français, du verbe faillir : manquer. Le substantif qui en découle désigne donc un manque, un défaut. De quelle faille s'agit-il ici ? Il est d'ores et déjà possible de déterminer une différence primordiale dans la thématique et le lieu du roman. J'ai expliqué dans mon billet concernant Le jour avant le lendemain que Jorn Riel est un explorateur du XXème siècle avant d'être écrivain. Spécialisé dans les régions nordiques, ayant vécu vingt années au Groënland, il rapporte de ses périples tous ses récits, donne vie à cette région hostile et méconnue du globe, offre la parole au peuple Inuit que j'admire particulièrement. Sa plume reste sensible et divine, à tous égards.
Mais voilà que La faille demeurait inexorablement sur une étagère de ma bibliothèque, sans vie, sans âme; moi qui adore Jorn Riel et ses récits sur le peuple inuit, je laissais de côté La faille. Il était donc plus que temps, en cette période de vacances, que je me décide à effleurer ce livre...
Qu'est-ce qui a rendu ma lecture tardive de ce roman ? Et bien cette faille justement ! Jorn Riel nous propose un nouveau voyage : loin du froid insipide du Groënland, l'écrivain, le grand voyageur, nous embarque pour la Nouvelle-Guinée, et son peuple autochtone. Les Papous. Dépaysement garanti.
Nous y voici donc ! Quel traumatisme ! La faille garde cette place UNIQUE dans l'oeuvre de Jorn Riel, le SEUL roman dont le cadre spatio-temporel n'est pas le Groënland ni les Inuit ! Alors, découvrons, osons, savourons des horizons inconnus... Jorn Riel est incapable de me décevoir...
Le Docteur Julius Horton vit à Wamena, petite ville de la vallée de Baliem, en Nouvelle-Guinée. Depuis trente ans, l'île est devenue son univers, son pays. Pour rien au monde il ne ferait demi-tour vers l'Europe. Il en a vu, des curieux avides d'aventures, débarquer sur l'île, mais aucun ne résiste longtemps à la vie sauvage qui les attirait initialement. Horton, lui, s'occupe des habitants. Bien connu des tribus papous, il soigne les blessés, les malades, les victimes de guerres tribales. Il a appris à comprendre ces différents peuples qui vivent dans la vallée. On le respecte.
Tout commence lorsqu'un certain Louis Schultz débarque à Wamena. Un être étrange selon Horton : on ne sait qui il est ni pourquoi il est venu jusqu'ici. Horton le croit incapable de réussir à mener des expéditions dans la jungle, marchant longuement sous une chaleur torride : rien qu'« un foutu touriste », bougonne-t-il. Gregers Hahnmuller, missionnaire chrétien, le pense bon : « c'est un homme bon, Julius […]. Même toi tu dois le voir. Mais un homme qui ne sait pas encore où diriger sa bonté » (p.10). Contre toute attente, Schultz va rapidement s'habituer à sa nouvelle vie, suivant le Docteur Horton dans ses déplacements, s'intégrant étonnamment au sein des tribus visitées. Rien ne le chagrine : ni la chaleur, ni les kilomètres, ni les désagréments liés à la vie des « sauvages » : « Ce qui est bizarre avec ce type […], c'est qu'apparemment il peut tout supporter. Il ne paye pas de mine, mais quelle santé ! »(p.19). De plus, Schultz semble loin d'être idiot : « Il me déroute, cet homme-là […]. Il en sait plus qu'il n'en dit. T'aurais dû le voir examiner Kusa Walilo. Carrément professionnel. Il a fait plus que toucher à la médecine. Un petit gars vraiment doué. Il parle déjà aussi bien le dani que moi. Il a de l'oreille, ma petite Madé, l'oreille absolue, ce type. Et c'est clair qu'il a étudié la médecine et que c'est un sacré diagnostiqueur. Qu'est-ce qu'il peut bien fuir ? » (p.17)
La présentation des personnages est très rapide, mais couronnée de succès : sa précision, son efficacité, permettent au lecteur d'avoir une idée juste de chacun d'entre eux. Très vite, nous sommes plongés au coeur de l'action lorsque Schultz prononce une requête improbable à l'adresse de Horton : « Pourriez-vous m'aider à me rendre sur les hauts plateaux de l'intérieur, docteur Horton ? Là où il y a une tache blanche sur la carte ? » (p.22). La réponse attendue de Horton ne traîne pas : « Vous ne survivrez pas deux heures sur les plateaux. D'ailleurs personne ne les connaît. Personne ne sait comment sont les tribus là-bas, sinon par quelques rumeurs éparses qui parviennent jusqu'à la vallée. Et je peux vous assurer que ce qu'on entend ici sur leur cruauté peut vous faire faire de sacrés cauchemars la nuit. Oubliez ! »(p.23)
Schultz est malin et se tourne alors vers Georges Stilton, pilote d'un vieux coucou, comme il l'appelle lui-même. Lui demandant de l'emmener survoler les hauts plateaux, il convainc le pilote de se poser et en profite pour fuir dans la jungle, à quelques centaines de mètres d'une tribu inconnue... En repartant, dépité d'avoir laissé l'homme dans cette contrée barbare, certain de son sort, le pilote raconte ce qu'il vit : « Schultz ! Imagine, il s'était assis par terre et est resté planté là, à moitié caché par les hautes herbes, pareil à un vrai fossile. On aurait dit qu'il attendait quelqu'un. Planté là au milieu de rien, il attendait ! »(p.33).
Le temps et les années passent, le sort de Schultz ne laisse aucun doute. L'âme du jeune homme plane pourtant et laisse perplexe. Horton en parle souvent. Que lui a-t-il pris ? Pourquoi cette folie ? Qui était-il ?
Seule la vie de Wamena se transforme, se peuple, s'urbanise, se modernise. Les tribus continuent d'échapper à l'homme blanc et ses police, lois, interdictions...
Dix-huit années après la disparition, la fugue de Schultz, deux hommes d'une tribu des hauts plateaux se présentent, réclament Horton, en possession du médaillon autrefois porté par Schultz. Accompagné de Hahnmuller, Horton prend la route. Direction : les hauts plateaux, une tribu inconnue. Est-ce un piège pour s'emparer de lui, le manger ? Est-ce un véritable appel ?
Le face à face a lieu quelques jours plus tard : Schultz est vivant, se fait appeler Yonokma, et est le terrible chef de la tribu qui porte son nom. Guerrier, stratège, fort, le chef Yonokma est redouté sur tous les territoires alentours. Comment en est-il arrivé là ? On ne le saura jamais. S'il a fait venir Horton, c'est pour une seule raison : Lalu est son nom. Gravement malade, Schultz-Yonokma a une requête, tout aussi surprenante que la première : il eut plusieurs enfants de ses différentes femmes, mais Lalu est celle qui le comble. Elle lui ressemble. Il a décidé pour elle qu'elle devait vivre ailleurs que dans la tribu, redescendre dans la vallée, et c'est Horton qui en prendra la charge :
« Lalu, chuchota Schultz, est différente...un mélange d'eux et de moi. Horton... amène mon enfant à Wamena ! »
Julius Horton regarda Schultz avec étonnement. « Votre enfant ? Pourquoi ? »
Schultz se mit à tousser et se recroquevilla de douleur. Le guérisseur posa une main noire sur son bas-ventre et appuya un peu pour soulager la douleur.
« Elle...ne survivra pas ici, dit Schultz peu après. L'héritage, Horton. Lalu c'est moi, Schultz...plus que...Yonokma. » (p.93).
Le sort de l'enfant ayant été décidé par son père, elle ne peut refuser, et a accepté l'idée d'ailleurs depuis bien longtemps.
Nous suivons alors pas-à-pas les mois suivant l'arrivée de Lalu à Wamena, son adaptation à la vie urbaine, à l'école. La jeune fille se montre vive d'esprit, intelligente, sociable, elle parle anglais, chose extraordinaire ! Schultz lui parlait sa langue maternelle tout le temps dans son enfance, sans doute pour la préparer à son retour dans la civilisation. Mais Lalu fugue souvent. Indécise. Je vous laisse le plaisir de découvrir l'évolution de Lalu, son avancée, son cheminement...
Tout s'éclaire. La faille est symbolisée par la jeune Lalu. C'est elle dans le roman, héroïne de tout un peuple, heroïne de tout être de « sang-mêlé », fruit d'un métissage imprévisible. C'est elle qui manque à une tribu ou à une ville, une famille nouvelle. C'est aussi à elle que manquent ces êtres : sa tribu natale ? Le couple Horton ? Qui choisir ? Pourquoi choisir ?
Plus que la vie des Papous, ce roman s'édifice comme une quête de soi. Qui est-on lorsque l'on appartient à deux patries que tout oppose, qui s'entretuent même ? A qui s'identifier ? Comment, enfant du métissage, vivre ses deux cultures pleinement, sans regret, sans manque, sans faille ? Comment allier Papou et Blanc, vie sauvage et civilisation ? Comment vivre lorsqu'on ne se sent jamais chez soi, lorsqu'on a besoin d'être ici et là-bas ? Ce sont toutes ces questions que soulève ce roman, et beaucoup de lecteurs s'y reconnaîtront sans doute. Peut-être que certains parmi vous auront envie de s'exprimer, d'expliquer comment assurer ce pari audacieux de représenter deux peuples et deux cultures...
Au son de cette quête, c'est une fois encore la défense des différences, la condamnation des pratiques des Blancs envers leurs semblables colorés à la vie archaïque, qui résonnent dans ces pages. Comment expliquer le monde, l'évolution des peuples, les jugements, la cohabitation entre tous. Les personnages mis en scène ici sont pourtant rassurants et figurent probablement parmi les caractères trop rares de la présence blanche en terre étrangère.
J'ai particulièrement aimé le dialogue entre l'homme de foi et le médecin sur le thème de la guerre, la « barbarie » comprise comme telle par l'homme blanc :
« Mais la guerre, docteur ? Demanda le plus petit des prêtres. Pourquoi ces effusions de sang ? »
Horton le regarda d'un air lointain. Il n'avait pas la moindre envie d'expliquer la guerre. La tradition, la démonstration de splendeur et de puissance, la vendetta. Il y avait le choix, la guerre avait beaucoup de visages. La cruelle et impitoyable guerre de surprise, où l'on tuait pour tuer. Les guerres rituelles qui apaisaient les esprits inquiets des ancêtres. La guerre faisait partie du quotidien, c'était un déversoir pour l'agressivité. Comme chez les animaux. Nourriture, femelles et territoire de chasse. Mais les animaux se contentaient de totale soumission, l'homme allait plus loin et tuait ses congénères, poussé par la politique, le désir de pouvoir ou la religion
« La guerre ? » redemanda le prêtre.
Horton détourna le regard de son interlocuteur et attrapa la bouteille de Cognac de Hahnmuller. Tout en versant, il dit : « Je n'ai pas envie de parler de la guerre, car aucun de nous ne comprend que c'est la mère de tout, que pour les tribus elle comporte une beauté cruelle. Autrefois, quand les Liklok étaient nomades, la guerre était rare. Les indigènes qui vivent au milieu de la jungle, là-bas, sont paisibles et aimables, même envers leurs femmes. »
« Qu'est-ce qui les transforme ? »
« Ils deviennent sédentaires. Possesseurs d'un territoire qui doit être défendu. Et tout va à peu près bien tant que les tribus sont de force égale, comme ils l'étaient à Siab il y a quelques jours. Mais de temps en temps surgit un meneur et alors le diable est lâché. »
Il vida son verre et jeta un regard à la ronde avec un sourire en coin. « c'est à peu près ce que vous pouvez vivre vous-mêmes dans nos sociétés hautement civilisées. Ne croyez surtout pas qu'il y ait une grande différence entre eux et nous, messieurs. » (p.47-48)
Ou encore, cette vision de la religion chrétienne par l'homme de foi lui-même :
« Le soir, après le repas, elle resta assise avec les autres filles sur la véranda devant la maison et écouta Hahnmuller qui leur lisait la Bible à haute voix. Il ne forçait jamais ses élèves à assister à ces lectures car le christianisme n'était pas quelque chose qu'on imposait aux gens. La foi, on la cherchait parce qu'il vous manquait une dimension dans l'existence. »(p.156).
Un livre à lire, encore, sans oublier le regard de l'ethnologue qu'est Jorn Riel. Chaque roman, chaque racontar, s'inscrit dans la fiction, certes, mais le grand voyageur s'inspire de ce qu'il a vu, témoin d'une vie autre, sauvage, et ses romans ne sont pas des ouvrages documentaires mais figurent tels de riches empreintes de ce que le conteur a pu observer.
La faille de Jorn Riel, Editions 10/18, première publication 2000, 270 pages.






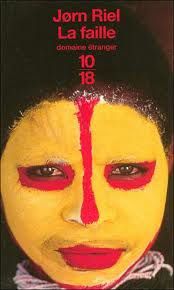



![images[4]](http://img.over-blog.com/300x300/5/13/39/18/images-4-.jpg)